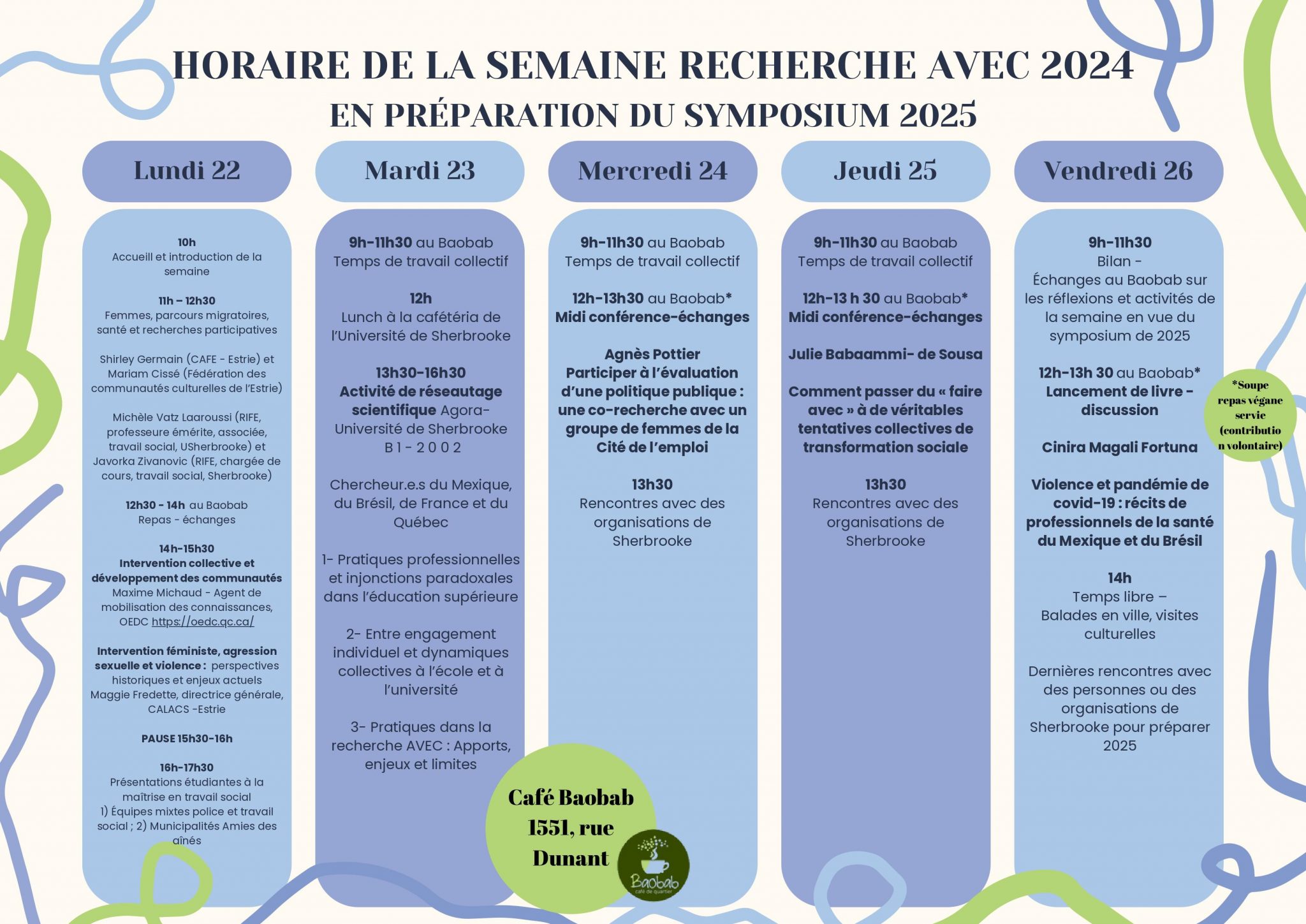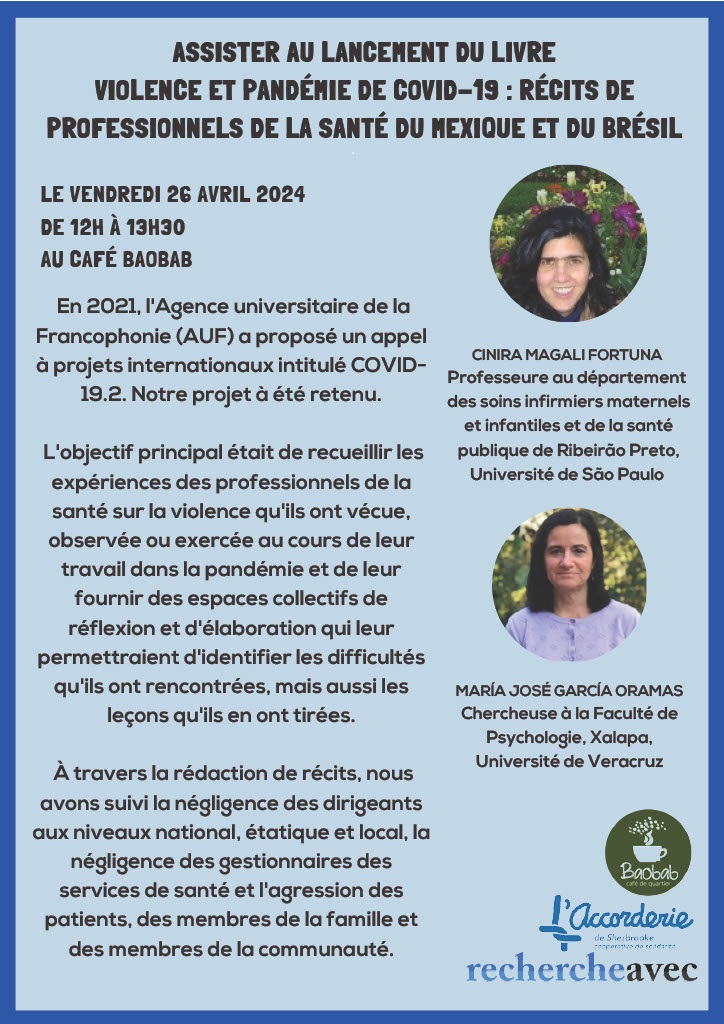À l’été 2013, alors étudiante à la maîtrise en histoire à l’Université Concordia sous la supervision de Steven High, j’ai passé deux mois dans la communauté innue de Nutashkuan (Natashquan) pour y mener un projet d’histoire orale. Ma recherche portait sur la création de cette réserve dans les années 1950, à partir des souvenirs de certains membres de la communauté. J’ai écrit ce texte pour mes ami.e.s alors que j’étais à Nutashkuan depuis quelques semaines; depuis, j’ai compris toute la richesse d’une recherche ancrée dans un territoire, et portée par les rencontres qui s’y produisent. On peut consulter mon mémoire de maîtrise ici.
***
Je suis à Natashquan depuis presque trois semaines et je ne vous ai encore rien dit. J’y suis venue tout le mois de juin aussi et je n’ai pas écrit non plus. On dirait qu’à mesure que j’y reviens, mon regard s’émousse. Il n’est plus neuf. Les phrases ne se construisent plus toutes seules dans ma tête. Natashquan devient un lieu de quotidien. Et c’est comme si je n’avais rien à dire.
Peut-être qu’à mesure que je connais les gens et les lieux, j’éprouve aussi un certain malaise à vous les décrire en termes exotiques, en terres du bout du monde. J’hésite à vous parler d’un peuple que je connais un peu mieux, mais encore tellement mal. Dont je ne parle même pas la langue, à peine trois ou quatre mots – j’essaie un peu, mais c’est dur, l’innu.
Je cherche ma place. Parfois j’ai l’impression de la trouver. Quand des gens me reconnaissent et qu’ils ont l’air, sincèrement, contents de me revoir. Aude! Quand est-ce que t’es revenue? Pis t’es-tu là longtemps? Pis tu restes où? Pis ça avance-tu tes affaires? Pis tu viens-tu cueillir des bleuets en fin de semaine? Je me dis que petit à petit, au gré des allers et retours, je m’ancre un peu ici. Pas complètement. J’appartiendrai toujours à la catégorie des gens «qui vont repartir». Je viens, je passe.
Il y a deux semaines, je suis allée aux chicoutais avec Adèle. Les chicoutais, c’est pénible à cueillir. Ça pousse dans les grands espaces austères de la tourbière, là où on enfonce avec les bottes de pluie dans une mousse rouge épaisse imbibée d’eau stagnante. Ça fait sfloutch sfloutch à chaque pas et c’est fatigant. Il y a des mouches, il fait chaud, et il faut faire quinze pas pour cueillir, au bout d’une petite tige, une sorte de framboise molle et dorée. En plus, ce n’est pas vraiment bon, les chicoutais.
En marchant dans la tourbière, Adèle me parlait beaucoup. Me racontait le paysage. J’ai appris que les femmes innues faisaient sécher la mousse de sphaigne, qui est incroyablement absorbante, pour faire des couches aux jeunes enfants, en la plaçant entre deux linges de coton. Appris qu’elles partaient tôt le matin, avec leur sac, et venaient cueillir dans la plaine, avant de retourner au campement le soir, pendant que les hommes étaient partis plus haut dans le bois pour chasser. Appris à reconnaître des plantes toxiques et des canneberges sauvages qu’on reviendra cueillir plus tard. Appris aussi où il faut passer dans la tourbière – éviter les trous noirs et les sections jaunâtres, parce qu’on risque de s’enfoncer jusqu’à la taille. Conclu à mon immense dépendance de son savoir.
En sortant de là quelques heures et quelques chicoutais plus tard, je me suis dit, mais qu’est-ce que je vais faire de toute cette connaissance – millénaire, magnifique, infiniment locale, dramatiquement inutile? Je comprends – j’entrevois – le drame des aînés qui ont grandi dans ce territoire, qui doivent leur survie à cette connaissance intime de chaque recoin de terre, et qui voient bien que ça ne sert plus à rien, maintenant que les couches et les confitures s’achètent à l’épicerie. Alors raconter tout ça, revivre les lieux, se souvenir, oui, mais pourquoi? Pour que ça se garde, comme ça, comme un monument érigé au passé, à la nostalgie d’une vie qui n’existe plus?
J’exagère un peu, évidemment. Adèle, qui a 70 ans passés, vit encore ce territoire. L’année passée, elle est venue aux chicoutais avec sa sœur, Maniakat. Elle me montre l’endroit où elles avaient fait un feu et grillé de la morue. Me dit qu’elles étaient bien. Quand elle parle de sa sœur aînée, des moments avec elle dans le bois, il y a une tendresse immense et une grande reconnaissance pour ce temps qu’elles passent ensemble. Mais Adèle pense que Maniakat n’aura pas la force, cette année, de marcher dans la tourbière. Alors, pour combien de temps encore?
J’essaie de mettre de l’ordre dans tout ça, dans toutes ces informations éparpillées que je récolte à gauche et à droite. Ma vie ici a quelque chose de l’ermite et du détective. Il n’y a pas d’archives, juste la mémoire des gens, de vieilles cassettes poussiéreuses, des boîtes qui traînent un peu partout et des documents épars. Tomber sur quelque chose d’intéressant tient de la chance. Il faut fouiller, demander, rafistoler des histoires et bricoler des réponses quand il ne reste plus de traces. Je n’ai pas encore fait d’entrevues «officielles» – j’essaie de ne pas pousser, de prendre le temps, de prendre sur moi le stress des semaines qui filent et du résultat qu’il faudra produire un jour.
Et si on me demande, mais qu’est-ce que tu cherches, au juste?, j’ai envie de répondre, je ne sais pas. Il y a tellement de questions, de choses à apprendre, à comprendre, à dire, mais parfois tout se mêle comme dans un grand brouillard, et je ne sais plus. Dans ces moments-là, je ferme tout et je vais marcher sur la plage, ramasser des dollars de sable et regarder les couchers de soleil. Et je me dis, voilà, c’est quand même le paradis, ici.
Crédits photos : Aude Maltais-Landry.
***
POUR REJOINDRE L’AUTEURE :
Aude Maltais-Landry, M.A. Histoire
Université Concordia
audemaltais@yahoo.ca